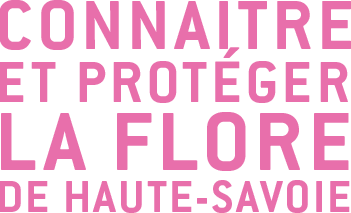Gratiole officinale
Gratiola officinalis - L.Scrophulariaceae | Zones humides de plaine
C’est une plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche rampante-stolonifère. Les tiges feuillées, dressées, sont creuses, quadrangulaires au sommet. Les feuilles (de 2 à 5 cm de long) sont opposées, entières et lancéolées, sessiles, presque embrassantes à la base, trinervées, et denticulées en scie dans le haut. Les fleurs, solitaires sur des pédicelles filiformes, sont disposés sur la tige à l’aisselle des feuilles supérieures, ces dernières étant plus longues que les pédicelles. La corolle d’un blanc rosé avec le tube jaunâtre, est assez grande (de 15 à 18mm) et tubuleuse. Elle possède 2 lèvres peu marquées, la supérieure à 2 lobes et l’inférieur à 3 lobes. Le calice quant à lui est constitué de 5 sépales lancéolés et muni à la base de 2 bractées linéaires. Le fruit est une capsule ovoïde-conique, égalant le calice, à 2 loges contenant de nombreuses graines. Lorsqu’elle n’est pas fleurie, elle peut-être difficile à reconnaître dans son milieu où elle peut repérable et peut-être confondu avec des individus non fleuris du genre Veronica qui se développent dans les mêmes milieux humides.
Voir la fiche simplifiée Voir la fiche détailléeStatut patrimonial
- Liste rouge nationale 1 :
- Liste rouge régionale :
- Inventaire flore menacée 74 :
- Espèce protégée : national
-
Présence en Haute-Savoie :
Biologie
C’est une hémicryptophyte à floraison estivale, de mai à septembre. La pollinisation est effectuée par le vent et les graines disséminées à proximité du pied-mère. L’espèce se multiplie également par voie végétative à partir de son rhizome mais ne forme jamais de populations nombreuses et étendues.
-
Type biologique : Hémicryptophyte

- Floraison : de mai à septembre
- Mode de pollinisation : anémogame
- Mode de dissémination : barochore
- Type de reproduction : sexuée
Ecologie
La Gratiole est une plante des prairies humides, inondées l'hiver, fauchées ou pacagées. Elle peut également se rencontrer dans des marais, des queues d'étangs, et même parfois les berges des rivières à cours lent, voire même les fossés. Elle est présente du collinéen au montagnard inférieur.
Etage de végétation
collinéen au montagnard inférieur
Répartition
Mondiale
C’est une espèce eurasiatique, présente de la France jusqu’à l’Asie occidentale et boréale,en passant par l'Ukraine, l’Europe centrale et même méridionale (au Portugal). Elle est également présente en Amérique du nord mais y aurait peut-être été introduite
Française
En France, elle est disséminée sur l'ensemble du territoire, mais avec une distribution très inégale : absente, du Nord, des Pyrénées, de Franche-Comté et du sud du Massif central, elle est plus commune en Bretagne, en Limousin, et dans le sud-ouest mais néanmoins en régression notable.
Régionale
En Rhône-Alpes, elle est signalée dans tous les départements mais en forte régression.
Départementale
En Haute-Savoie, l’espèce était connue de 4 localités de 1889 à 1928, où elle n’y a été pas retrouvée, mais est par contre présente dans deux marais du bassin lémanique et un marais du bassin rhôdanien.
Menaces & actions de préservation
L’espèce est menacée par des atteintes directes sur les biotopes qui l’hébergent (drainages des zones humides, pollution des mares et étangs, régulation des berges des rivières, etc.). Dans certains cas, il est également nécessaire de prendre en compte l’espèce pour la définition des périodes d’exploitation des prairies humides par la fauche pour permettre à l’espèce de grainer et disséminer ses semences. Elle a fait l'objet de cueillettes importantes à cause de ses propriétés médicinales, ce qui a peut-être aussi contribué à sa raréfaction dans certaines régions. Ses parties aériennes sont toxiques, et auraient même été accusées d’empoisonner le bétail dans certaines régions, mais les parties souterraines étaient très employées en médecine populaire comme vomitif et vermifuge. En Haute-Savoie, une des stations se trouve dans un complexe de prairies humides inscrites au réseau Natura 2000 et pour lesquelles des mesures de gestion conservatoire ont été mises en place. Dans cette station, la gratiole a également été intégrée dans un plan d’action mis en place dans le cadre d’un programme INTERREG transfrontalier développé avec le Canton de Genève. La seconde station se trouve également dans un site Natura 2000, des mesures de gestion conservatoire y sont prévues mais n’ont pas encore pu être mises en place sur la station.